Qu’est-ce que la déprescription ?
La déprescription, ce n’est pas simplement arrêter un médicament. C’est un processus clinique structuré qui consiste à évaluer si les risques d’un traitement dépassent ses bénéfices pour un patient donné. Cette approche s’adresse surtout aux personnes âgées qui prennent cinq médicaments ou plus - une situation appelée polypharmacie. Selon l’Organisation mondiale de la santé, près de 40 % des personnes âgées dans le monde prennent des médicaments inappropriés ou superflus. Résultat ? Des effets secondaires, des chutes, des hospitalisations, et une qualité de vie altérée. La déprescription vise à inverser cette tendance, pas en supprimant tout, mais en supprimant ce qui ne sert plus.
Pourquoi la déprescription est-elle nécessaire aujourd’hui ?
Les gens vivent plus longtemps, mais pas toujours mieux. Les traitements prescrits il y a 10 ou 20 ans ne sont plus adaptés à leur état actuel. Un antihypertenseur pris pour une pression qui s’est normalisée, un benzodiazépine pour l’anxiété passée, un inhibiteur de la pompe à protons pour une brûlure d’estomac qui a disparu : ces médicaments deviennent des fardeaux. Une étude de la Société américaine de gériatrie en 2023 montre que la polypharmacie contribue à 30 % des hospitalisations chez les plus de 65 ans. Et pourtant, peu de médecins osent arrêter ces traitements - par peur, par habitude, ou parce qu’ils n’ont pas de cadre clair pour le faire.
Les cinq classes de médicaments ciblées par les cadres de déprescription
Les experts ont identifié cinq groupes de médicaments où la déprescription a le plus d’impact. Ce ne sont pas des choix arbitraires : ce sont des traitements fréquemment prescrits, souvent inutiles à long terme, et potentiellement dangereux.
- Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) : prescrits pour les brûlures d’estomac, mais souvent pris des années sans réévaluation. La déprescription suit un protocole en 4 étapes : vérifier l’indication, réduire progressivement la dose sur 4 à 8 semaines, surveiller les symptômes, et arrêter si possible.
- Benzodiazépines et agonistes des récepteurs : utilisées pour le sommeil ou l’anxiété, mais augmentent le risque de chutes et de démence. Le retrait se fait lentement, avec un suivi régulier.
- Antipsychotiques : souvent prescrits pour les troubles du comportement chez les personnes atteintes de démence, alors qu’ils augmentent le risque de décès. La déprescription ici est une question de sécurité.
- Antihyperglycémiques : chez les personnes âgées avec diabète de type 2, un taux de sucre trop bas peut être plus dangereux qu’un taux légèrement élevé. Réduire les doses ou arrêter certains traitements améliore la sécurité.
- Analgésiques opioïdes : pour la douleur chronique, les bénéfices à long terme sont limités, les risques (dépendance, constipation, somnolence) sont élevés. Un retrait progressif peut améliorer la vigilance et la mobilité.
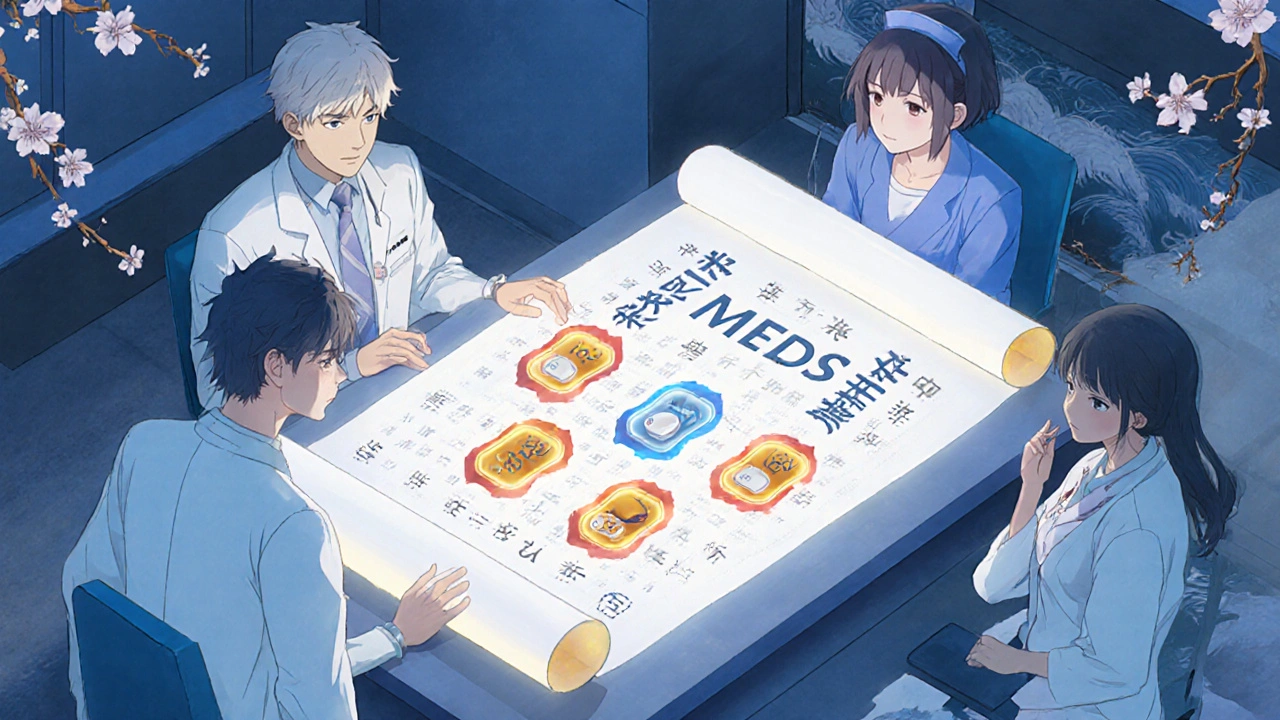
Le cadre Shed-MEDS : une méthode validée par la recherche
Un des cadres les plus rigoureux est Shed-MEDS, développé par des chercheurs canadiens et validé dans un essai clinique publié dans JAMA Internal Medicine en 2023. Il repose sur quatre étapes :
- Best Possible Medication History : recueillir la liste complète des médicaments, y compris ceux pris sans ordonnance.
- Evaluate : évaluer chaque médicament selon l’état actuel du patient, ses objectifs de soins, et les lignes directrices.
- Deprescribing Recommendations : proposer des arrêts ou réductions ciblés, avec un plan de retrait progressif.
- Synthesis : documenter les décisions et les transmettre à l’équipe soignante et au patient.
Dans cette étude, les patients ont vu leur nombre de médicaments réduit de 11,3 à 9,5 au moment de leur sortie de l’établissement de soins de suite. À 90 jours, la réduction était encore de 1,6 médicaments en moyenne. Et ce n’est pas tout : le taux d’effets indésirables était exactement le même que dans le groupe de contrôle. La déprescription n’est pas risquée - quand elle est bien faite.
Le rôle clé des pharmaciens
Les médecins ne peuvent pas tout faire seuls. La déprescription réussit mieux quand un pharmacien est impliqué. Une étude canadienne montre que les équipes avec pharmacien ont 35 à 40 % plus de chances de réduire efficacement les médicaments. Pourquoi ? Parce que les pharmaciens sont formés pour analyser les interactions, repérer les doublons, et connaître les protocoles de retrait. Dans les établissements où les pharmaciens participent aux visites de suivi, les patients arrêtent plus de médicaments en toute sécurité. Le problème ? Dans les cabinets de médecine générale, les pharmaciens sont rares. En France, moins de 15 % des médecins généralistes intègrent un pharmacien dans leur processus de révision médicamenteuse.
Les obstacles à la mise en œuvre
Malgré les preuves, la déprescription reste marginale. Pourquoi ? Trois freins majeurs :
- Le temps : un médecin passe en moyenne 7,2 minutes par patient. Il faut 20 à 30 minutes pour faire une bonne déprescription, avec explication et dialogue.
- La peur : les médecins craignent que le patient ne se sente abandonné, ou que la maladie ne revienne. Mais les études montrent que la plupart des symptômes réapparaissent seulement si le médicament était vraiment nécessaire.
- Les systèmes informatiques : les dossiers médicaux électroniques sont conçus pour prescrire, pas pour arrêter. Ils ne proposent pas d’alertes pour les médicaments inutiles, ni de modèles de retrait. Un médecin sur trois se sent mal équipé techniquement pour déprescrire.

Comment commencer à déprescrire ?
Vous n’avez pas besoin d’être un expert pour commencer. Voici trois étapes simples :
- Faites un inventaire complet : demandez à votre patient de vous apporter tous ses médicaments - comprimés, gélules, patchs, gouttes. Notez la dose, la fréquence, et la raison initiale de la prescription.
- Posez la question clé : « Si vous deviez choisir un seul médicament à arrêter aujourd’hui, lequel serait-ce ? » Cela ouvre la porte au dialogue, pas à l’ordre.
- Commencez par un seul médicament : ne tentez pas de tout arrêter en une fois. Choisissez celui avec le moins de bénéfice et le plus de risque. Par exemple, un IPP pris depuis 5 ans sans réévaluation.
Utilisez les outils gratuits de deprescribing.org : ils proposent des algorithmes clairs pour chaque classe de médicament, avec des tableaux de retrait et des fiches pour les patients.
Les patients, au cœur du processus
La déprescription ne marche pas si le patient n’est pas d’accord. Une étude qualitative en 2022 a montré que 65 % des personnes âgées se sentent soulagées quand elles réduisent leur nombre de pilules. Mais 22 % ont peur : « Et si je me sens mal après ? » « C’est ce que mon médecin m’a prescrit, je ne peux pas l’arrêter. »
La clé ? L’éducation. Donnez aux patients des documents simples : « Pourquoi on arrête ce médicament », « Ce qu’on peut attendre », « Quand appeler ». Un patient informé est un patient qui accepte. Une étude montre que les patients qui reçoivent une explication écrite sont deux fois plus susceptibles de suivre le plan de déprescription.
Le futur de la déprescription
La tendance est claire : la déprescription devient une norme. En 2024, l’American Medical Association a adopté une politique exigeant que les médecins réévaluent régulièrement tous les médicaments. Aux États-Unis, les métriques de déprescription seront intégrées au système de paiement des médecins en 2026. L’Union européenne l’a inscrite dans sa stratégie pharmaceutique. Et en 2030, selon certains experts, vérifier la pertinence des traitements sera aussi courant qu’une prise de tension.
Le défi ? Il reste plus de 500 combinaisons de médicaments sans protocole de déprescription. Les chercheurs travaillent sur les anticoagulants, les antidépresseurs, les traitements contre l’ostéoporose. Mais le plus grand obstacle n’est pas technique - c’est culturel. Il faut changer la mentalité : prescrire, ce n’est pas toujours mieux. Parfois, arrêter, c’est soigner.
La déprescription est-elle sûre pour les personnes âgées ?
Oui, quand elle est bien menée. Une étude de 2023 sur 372 patients âgés a montré que réduire les médicaments ne augmente pas les risques d’effets indésirables. Au contraire, les chutes, les hospitalisations et les confusions ont diminué. La clé est le retrait progressif, le suivi régulier, et la prise en compte des objectifs de soins du patient.
Quels médicaments faut-il arrêter en premier ?
Commencez par ceux qui ont le moins de bénéfice et le plus de risque : les inhibiteurs de la pompe à protons pris depuis plus de 1 an sans indication claire, les benzodiazépines pour le sommeil, les antipsychotiques chez les personnes atteintes de démence, et les opioïdes pour la douleur chronique. Utilisez les guides de deprescribing.org pour identifier les candidats idéaux.
Est-ce que la déprescription signifie que je ne prends plus aucun médicament ?
Non. La déprescription ne signifie pas arrêter tous les médicaments. Elle vise à éliminer ceux qui ne sont plus nécessaires, dangereux, ou redondants. Les traitements essentiels - comme ceux pour l’hypertension, le diabète bien contrôlé, ou les maladies cardiaques - restent en place. L’objectif est la qualité, pas la simplicité à tout prix.
Qui peut aider à mettre en œuvre la déprescription ?
Les pharmaciens sont les meilleurs alliés. Ils peuvent analyser les interactions, proposer des alternatives, et guider le retrait progressif. Les infirmières formées à la gestion thérapeutique, les gériatres, et les équipes de soins à domicile peuvent aussi jouer un rôle clé. Dans les établissements où une équipe multidisciplinaire travaille ensemble, les taux de réussite sont deux fois plus élevés.
Comment convaincre un patient réticent à arrêter un médicament ?
Évitez de dire « vous n’avez plus besoin de ça ». Dites plutôt : « Ce médicament a été utile il y a 5 ans, mais votre corps a changé. On peut essayer de le réduire lentement pour voir si vous vous sentez mieux sans. » Montrez des données simples : « 70 % des personnes qui arrêtent ce médicament se sentent plus énergiques. » Proposez un essai de 4 semaines, avec un suivi. Le contrôle et la confiance sont plus puissants que la pression.
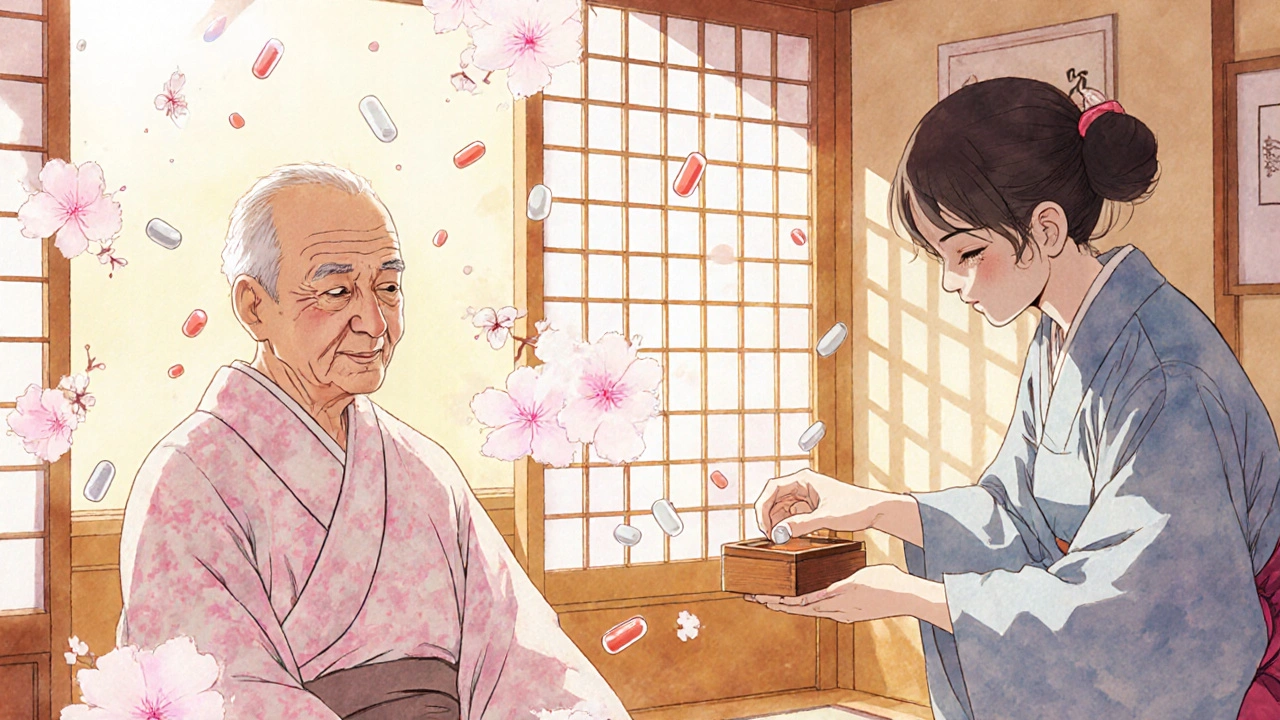
Christophe Farangse
novembre 26, 2025 AT 04:42Le corps sait se débrouiller.
Marcel Schreutelkamp
novembre 26, 2025 AT 06:43Je lui ai dit 't'as pas un petit cahier pour noter pourquoi t'as pris chaque pilule ?' Il m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Et pourtant... c'est pourtant si simple.
LAURENT FERRIER
novembre 27, 2025 AT 15:54Vous croyez vraiment que les médecins veulent vous aider ? Non. Ils veulent que vous restiez dépendants. Les études ? Truquées. Les pharmaciens ? Des agents de l'industrie. Et ce Shed-MEDS ? Un piège pour vous faire croire que c'est sûr. Attendez, dans 5 ans ils vont dire que l'aspirine tue aussi. Et vous allez les croire. Comme des moutons.
Forrest Lapierre
novembre 29, 2025 AT 10:19La vie, c'est pas une statistique. C'est un risque. Et vous, vous jouez avec.
Nathalie Rodriguez
novembre 30, 2025 AT 15:04Je suis sûr que c'est très élégant sur papier. En vrai, c'est juste un mot pour dire 'on sait pas quoi faire alors on arrête tout'.
Adèle Tanguy
décembre 1, 2025 AT 01:02Maurice Luna
décembre 2, 2025 AT 14:30Ça fait 3 ans que je crie ça sur les forums !
Arrêtez de remplir les gens de pilules comme des poupées russes !
Mon père a arrêté ses benzodiazépines, il a retrouvé sa mémoire, il danse avec sa femme le soir, il se souvient de mon anniversaire. Et vous savez quoi ? Il vit MIEUX.
Le vrai soin, c’est pas de prescrire, c’est d’écouter. Et de croire en la capacité du corps à se rééquilibrer.
Allez-y, osez. Vos patients vous remercieront. 💪❤️
manon bernard
décembre 3, 2025 AT 01:52On a oublié que les pilules, c'est pas juste de la chimie. C'est de la sécurité pour eux.
Mathieu Le Du
décembre 3, 2025 AT 10:55On a transformé la santé en industrie. Et les patients en consommateurs.
Alain Millot
décembre 5, 2025 AT 02:53